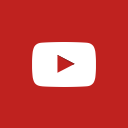L'existence de trous noirs supermassifs fugitifs, résultant de fusions de galaxies, est prédite depuis longtemps. Pour la première fois, en mars 2023, le télescope spatial Hubble avait donné un indice laissant penser qu’on en avait repéré un, avec l’existence d’une sorte de longue trainée de gaz choqué (voir nos épisodes 1469 et 1493). Aujourd'hui, l’équipe à l’origine de cette observation initiale a refait d’autres observations mais cette fois avec le télescope Webb. Les données confirment que cet objet se déplace à une vitesse supersonique dans le milieu intergalactique, perturbant le gaz diffus et créant un arc de choc. Les chercheurs estiment que cet objet est très probablement un trou noir supermassif, éjecté de sa galaxie et traversant le milieu intergalactique à grande vitesse. L’étude est à paraître dans The Astrophysical Journal Letters.
Source
JWST Confirmation of a Runaway Supermassive Black Hole via its Supersonic Bow Shock
Pieter Van Dokkum et al.
The Astrophysical Journal Letters, Volume 998, Number 1
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae3d0e
Illustrations
- Image du sillage obtenue par Hubble en 2023 et zone aujourd'hui observée avec Webb (Van Dokkum et al.)
- Modélisation 3D de l'arc de choc supersonique produit dans le milieu intergalactique (Van Dokkum et al.) 3.Pieter Van Dokkum